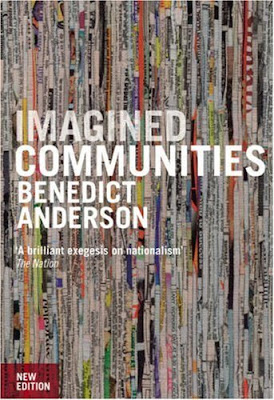Je sais, le terme d'identité fait aujourd'hui un peu l'effet d'un gros mot. A force d'être employé à toutes les sauces, pas toujours ragoûtantes d'ailleurs, sa cote s'est de beaucoup déprécié sur la bourse des notions intellectuelles. Ça veut dire tout et n'importe quoi, le correct comme l'incorrect, le meilleur comme le pire, soit donc à-peu-près rien. Pourtant, c'est bien à cela que nous avons affaire, dans l'appréciation la plus stricte et rigoureuse du concept. Faisons un petit retour en arrière.
Au début du XIXe siècle, les États européens en voie de modernisation découvrent leurs populations. Jusqu'alors, il n'y avait que deux critères d'appartenance.
*La caste comme en témoigne la subdivision en trois ordres (clergé, noblesse, tiers état) qui ne fait peut-être que prolonger une tripartition sociale constatée dans la plupart des civilisations indo-européennes.
*Le clan qui s'avère surtout effectif au sein de la noblesse où l'affiliation au lignage détermine tout un enchevêtrement sémiotique (blason, armes, terres…).
La révolution française et la révolution industrielle font sauter ce système caste-clan. Les ordres fusionnent en un seul marché et une seule communauté citoyenne. Le lien familial reflue dans la sphère privée.
La disparition de ce système laisse les pouvoirs publics assez démunis : ils sont de facto confrontés à une masse incertaine qu'il convient d'organiser selon des critères non plus mythiques ou biologiques mais rationnels. S'appuyant sur les sciences statistiques naissantes, les États mettent en place des recensements, soit des procédures visant non seulement à dénombrer mais aussi à classer les individus qui le compose. L'incarnation géométrique du classement, c'est la case, celle que coche ou remplit le recensé. Son équivalent conceptuel, c'est l'identité, soit au sens propre ce qui fédère des individus apparemment distincts par des caractéristiques identiques.
Or, les statisticiens se rendent rapidement compte de l'incomplétude et de l'incertitude du classement. D'une part, tout-le-monde ne rentre pas dans les cases : il reste des marges, des marginaux qui se situent par-delà le classement programmé. D'autre part, les diverses statistiques nationales de coïncident pas. Assistant au congrès général de la statistiques de 1853, Adolphe Quételet remarque :
Chacun de vous sans doute a été frappé du défaut d'unité qu'on rencontre en général dans les documents statistiques des différents pays, et de l'impossibilité où on est, presque à chaque instant, d'établir des comparaisons entre eux […] Devant ces trésors réunis, ce n'était pas seulement la confusion des langues qui faisait obstacle à l'échange des idées, c'était surtout l'insuffisance où l'on était de comparer tant de choses et de ramener à une même appréciation les forces et les richesses de tant de nations.Bref, si les méthodes statistiques sont scientifiques ce n'est pas le cas de leurs a-priori. Les cases ou identités sont définis en amont, tantôt par un conditionnement socio-moral, tantôt par des intérêts politiques. En témoigne, typiquement, les curieux aléas de la mention « religion » en France. Elle est créée en 1851 et subdivise les français en catholiques romains, calvinistes, luthériens et israélites. Elle disparaît en 1873 au début de la IIIe république.
La notion de « fille » ou de « mademoiselle » se situe dans cette orbite. Elle a été créée à une époque où le statut légal de la femme était déterminé par le mariage. Un homme marié ou célibataire dispose peu ou prou des mêmes droits, tant qu'il a atteint sa majorité. Inversement, l'article n°24 du code napoléon établit que :
Les personnes privées de droits juridiques sont les mineurs, les femmes mariées, les criminels et les débiles mentauxOn en déduit que la femme majeure, non mariée, dispose quant à elle d'un certains nombre de droits juridiques. C'est en fait assez délicat à établir, dans la mesure où le code napoléon n'aborde pratiquement pas leur cas. Celui-ci paraît excéder la « normalité » induite qui veut que chaque individu fonde une famille régie par des liens hiérarchiques où le mari (ou chef de ménage) domine la femme et les enfants. Ce qui sort de ce cadre est fatalement marginal. Françoise Gaspard résume cette situation en ces termes :
Le code civil français de 1804, qui a inspiré les droits civils dans de nombreuses démocraties, rédigé sans que les femmes aient leur mot à dire, a ensuite fait de la femme mariée une “mineure civile” — de la célibataire une étrangetéOr, si la célibataire est une étrangeté, elle est une étrangeté courante. Yannick Ripa estime que ce manque juridique concerne
20% des femmes de trente-cinq ans et 12% de la population féminine au-dessus de cinquante ans, aux recensements de 1850 et de 1896.Tenir pour marginal une « identité » aussi répandue et aussi distincte pose évidemment problème. C'est la raison pour laquelle, la case mademoiselle commence à émerger sur les documents administratifs : pour prendre en compte le statut particulier d'une population dont les droits diffèrent notablement de ceux des époux (pleinement majeurs) et des épouses (mineures).
Au regard de l'identité sexuelle, il y a donc trois grandes catégories admises au XIXe siècle. Elles couvrent à peu près l'ensemble des cas de figures légalement envisageables : l'homme (marié ou pas), l'épouse et la demoiselle ou fille. Par un effet de survivance archéologique, on retrouve encore cette catégorisation aujourd'hui. Or, elle ne veut plus rien dire.
La réforme des régimes matrimoniaux de 1965 contribue en effet à anéantir la principale distinction légale entre l'épouse et la demoiselle : la capacité à exercer un statut d'acteur économique autonome. Dès lors, l'ensemble des femmes majeures peuvent ouvrir un compte en banque et assurer une carrière professionnelle sans devoir rien à personne. Les évolutions successives du droit de la femme et la libéralisation du mariage entérinent cette fusion statutaire. L'épouse et la célibataire ne sont plus des personnes légales distinctes : elles disposent des mêmes droit fondamentaux.
La distinction entre nom de jeune fille et nom d'épouse est elle-même en voie de disparition, même si il existe à ce propos un certain effet de résilience sociale (suscité notamment par la survivance de la filiation patrilinéaire). La question a commencé à être régulièrement évoquée par des associations féministes au début des années 1970. La circulaire ministérielle n°5128 du 14 avril 1983 estime que :
C’est la loi du 6 fructidor An II qui fonde le droit au nom des citoyens français et ce droit est le même pour les hommes et pour les femmes. Cette loi dispose dans son article 1er « Aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance ». Aucun texte ne prévoit non plus que le mariage emporte changement de nom des époux. Les papiers officiels ne doivent donc pas comporter d’autre nom que le nom légal. L’apposition des mentions épouse, divorcée ou veuve, suivie du nom du conjoint est donc contraire à la loi.
Bref, je n'irais pas jusqu'à parler d'une violence psychologique de la case Mademoiselle, même si il est indubitable qu'elle perpétue une ordre social révolu marqué par la distinction stricte entre l'épouse mineure et la demoiselle marginale. Le vrai problème c'est que cette catégorie ne sert à rien. Elle représente un encombrement inutile qui n'apporte rien aux procédures publiques. Sa suppression n'est pas urgente. En attendant, son maintien me paraît aussi abscons que celui de l'ordonnance préfectorale du 16 brumaire an IX interdisant le port du pantalon aux femmes.